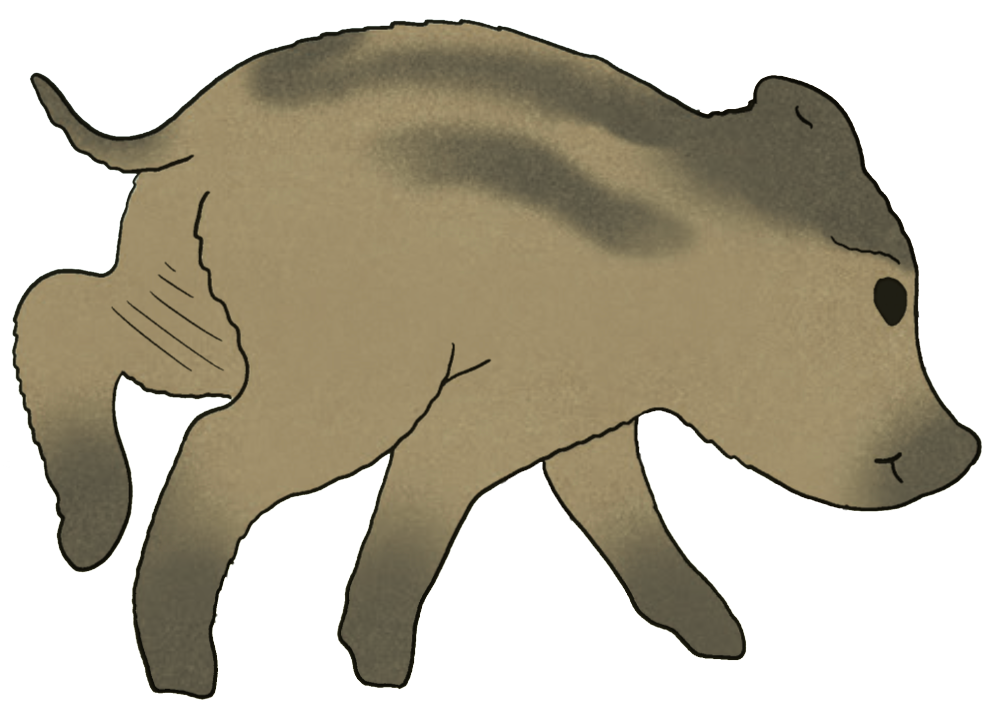Jérémie Moreau
© éditions 2042
Jérémie Moreau grandit en région parisienne. Dessinant avec assiduité, il participe chaque année, dès ses huit ans, au concours de bande dessinée du festival d’Angoulême — il obtient ainsi le Prix des lycéens en 2005 et, quelques années plus tard, le Prix Jeunes Talents, en 2012. Ses études le poussent ensuite vers l’animation. Diplômé des Gobelins, il devient character designer, puis revient à la bande dessinée avec Le Singe de Hartlepool, sur une histoire de Wilfried Lupano. Il publie ensuite, seul, les deux tomes de Max Winson. En 2018, avec La Saga de Grimr, il atteint une forme de consécration en obtenant le Fauve d’or au festival d’Angoulême, là où tout a commencé.
Avec Penss et les plis du monde (2019), son travail prend un tournant majeur, où la crise écologique, les rapports entre humains et animaux sont au centre des enjeux. Le Discours de la Panthère, La Chambre de Warren, Les Pizzlys et désormais Alyte : autant d’oeuvres qui témoignent de son souci d’habiter le monde autrement.
Bibliographie :
Alyte, éditions 2024
Le Discours de la Panthère, éditions 2024
Les Pizzlys, Delcourt
La Saga de Grimm, Delcourt
Penss et les plis du monde, Delcourt
…
découvrez aussi
☺
découvrez aussi ☺
Quelques questions à Jérémie Moreau,
à l’occasion de la sortie
de son livre :
ALYTE
En 2020, tu publiais chez 2024 Le Discours de la panthère, un recueil de fables animalières. Les Pizzlys, qui confrontait la cosmologie occidentale à celle des peuples d’Alaska. Cette histoire se focalisait sur le point de vue humain. Alyte au contraire renoue avec le principe de mettre en scène des animaux. Pourquoi as-tu eu envie d’imaginer le parcours d’un crapaud ?
J’avais pris beaucoup de plaisir à sortir du point de vue humain en réalisant Le Discours de la panthère pendant la crise du covid et j’avais très envie de remettre en scène des animaux en imaginant une histoire plus longue centrée sur le parcours d’un animal en particulier. Le choix du crapaud s’est imposé assez vite. La vie des batraciens me fascine parce qu’elle commence dans un milieu aquatique pour intégrer le milieu terrestre au passage à l’âge adulte. Tous les codes avec lesquels ces crapauds grandissent sont bouleversés. Je pensais à Aristote, à sa comparaison du philosophe en poisson volant capable de sortir de la surface des choses pour les contempler depuis un ailleurs, une autre dimension. Mais Alyte arrive aussi à la confluence de beaucoup de lectures et s’inscrit dans mon ambition de développer une esthétique qui accompagne le nouveau rapport à la nature porté par le grand élan écologique et philosophique actuel. En lisant Deleuze et les philosophes contemporains du vivant j’ai découvert par exemple Jakob Johann von Uexküll, un penseur allemand du XIXème siècle qui cherchait à transcrire les perceptions de la conscience animale. Il dessinait aussi. Pour lui, chaque espèce y compris les humains voit le monde en fonction des signaux qu’elle capte. Pour représenter ces mondes en fonction des perceptions, il imagine des bulles pour chaque espèce, y compris les humains. J’ai moi-même retranscrit la cartographie du monde selon Alyte dans une double planche.
Les fables du Discours de la panthère mettaient plutôt en scène des animaux exotiques, à l’inverse Alyte est une espèce très commune avec cette spécificité que le mâle porte les œufs après la copulation. Est-ce le regard sur une nature de proximité qui a déterminé le choix de cette espèce ou bien cette caractéristique de paternité ?
Jean-Christophe Cavallin qui dirige un master d’éco-poétique à Aix-en-Provence m’avait conseillé d’observer la nature au plus proche pour éviter les clichés. J’ai découvert pour la première fois le crapaud accoucheur dans la petite mare en bas de chez moi. Par ailleurs dans mon village, j’ai un ami naturaliste qui m’a emmené un soir faire un tour avec une caméra thermique pour voir les animaux. C’était au moment du brame du cerf, et grâce à cette caméra on a vu quasiment en une soirée tous les personnages d’Alyte. C’est magique de réaliser la présence tout autour de nous de tous ces animaux qu’on ne voit jamais. Ensuite j’ai évidemment été séduit par le côté « féministe » de l’espèce, j’y ai projeté mon rôle de père, car j’ai porté ma fille pendant des heures quand elle était bébé et je n’ai pas eu de mal à concevoir ce sentiment de protection face à la vulnérabilité des œufs dont Alyte a la responsabilité.
Un saumon, un bouquetin, un hibou petit- duc, un chêne, les rencontres initient Alyte à la nature qui l’entoure dans un mouvement qui élargit progressivement la focale sur une vision plus globale. Comment as-tu pensé cette grande odyssée écologique ?
J’avais envisagé de faire plusieurs tomes autour de la vie du crapaud pour décrire plus précisément les milieux qu’il traverse. La nature est un réservoir à imaginaire très riche et je n’ai pas fini de travailler avec les animaux mais pour cette histoire, j’ai finalement choisi de me limiter dans la mesure où l’ambition était aussi de parvenir à faire le portrait des interactions qui régissent le monde naturel tout en gardant une lisibilité. Je me suis laissé guider par des démonstrations plus générales, comme le système de la répartition de l’énergie solaire à toutes les échelles du vivant ou les cascades trophiques décrites par Aldo Leopold sur les relations entre proie-prédateur. J’avais surtout ce désir de développer une mosaïque de points de vue en projetant pour chaque espèce sa propre cosmologie du monde dans le prolongement de mes lectures sur l’anthropologie qui ont nourri Les Pizzlys. Tous ces points de vue d’animaux permettent de prendre du recul par rapport à notre cosmologie naturaliste et capitaliste qui place l’homme hors de la nature. Ils rendent compte de la diversité des manières de se rapporter au monde et des interdépendances qui créent l’équilibre du vivant. Pour le saumon, en observant cette vie à remonter le courant, je pensais au conatus de Spinoza, cette puissance d’être, ce désir qui permet de tenir debout contre les forces de la mort. J’ai décliné cette idée en développant plus ou moins une cosmologie pour chaque espèce. Je m’inspire à droite à gauche, en lisant sur l’intelligence animale et végétale, en faisant des randonnées ou en regardant des documentaires animaliers comme le film Une vie de bouquetin, réalisé par l’observation d’un clan sur une dizaine d’années qui m’a inspiré le caractère de Plonk. Habiter en oiseau de Vinciane Despret m’a conduit à imaginer le merle qui n’arrive pas à couvrir le bruit de la route de son chant pour se faire entendre.
Comme dans Les Pizzlys tu utilises dans Alyte des compositions symboliques en double planches qui viennent graphiquement synthétiser un concept philosophique ou scientifique. Quel sens donnes-tu à ces projections abstraites ?
Quand je trouve une bonne idée graphique et métaphorique pour remplacer un long discours, je n’hésite pas. Dans Les Pizzlys je me suis passionné pour les cosmologies animistes, quand le crapaud voit le soleil s’infiltrer entre les insectes et les fleurs et qu’il comprend comment l’énergie circule entre toutes les choses, c’est un peu comme s’il avait une révélation et qu’il revoyait l’origine du monde, ce magma indéfini avant la spéciation décrite par les peuples d’Alaska. De même quand, à la fin, il traverse la route, emmenant avec lui toute la forêt, il devient l’aiguille qui recoud la grande couverture du vivant coupée par la léthalyte. L’image parle d’elle-même, elle évite les grands discours.
Le soleil se diffuse aussi à travers les jeux de lumière et les dégradés fluo. Quel rôle donnes-tu à la couleur ?
La couleur me donne les moyens d’exprimer par des sensations cette ontologie solaire, en faisant intervenir les spectres colorimétriques. C’est pourquoi on retrouve beaucoup ces effets arc-en-ciel, comme une force primordiale qui rajoute du sens au récit. Le parti pris fluo, ce choix de couleurs numériques, ultra synthétiques peut paraitre paradoxal pour une BD écolo. Quand j’utilisais l’aquarelle pour La Saga de Grimr ou Penss et les plis du monde, je travaillais beaucoup d’après photo, pour rester fidèle aux couleurs naturelles mais selon l’optique humaine. Avec Le Discours de la Panthère, en arrivant chez 2024, je suis allé vers les couleurs Pantone d’abord parce que j’étais séduit par cette innovation technique, attiré par la mode et j’avais envie de jouer avec ça. J’ai poussé le curseur de cette esthétique encore plus loin avec Les Pizzlys. Mais dans Alyte, c’est beaucoup plus délibéré dans la mesure où j’estime que pour parler d’écologie on n’est pas obligé de mettre toujours du vert ou des couleurs terreuses. D’ailleurs si on réfléchit la vision des insectes est complètement psychédélique et se rapproche sans doute plus de ce que je montre que notre vision naturaliste. Désormais je ne crains plus de faire des couleurs un peu kitsch. Dernièrement j’ai eu des discussions avec des cartographes qui cherchent eux aussi à inventer de nouveaux codes couleur pour rendre compte de réalités plus complexes, en abandonnant les conventions d’aplat sans nuance qui désignent le bleu pour la mer, le vert pour la forêt. Moi aussi je cherche de nouvellesmanières de représenter la nature et si je cherche toujours une beauté et un équilibre dans les contrastes et les saturations, je suis beaucoup moins limité. Un verrou a sauté et la couleur est devenue un grand espace de jeu.
Quelles sont les pistes pour inventer cette nouvelle esthétique du rapport à la nature ?
Cette idée s’est formalisée quand j’ai pris la direction de Ronces, une collection jeunesse chez Albin Michel. Quand j’étais petit, pour moi l’écologie, c’était un signe de recyclage sur les packs de lait. Un truc pas fun, comme les affiches de militants écolo qui reprennent toujours les mêmes codes, tous ces clichés éculés, moralisateurs, une liste d’images à proscrire. C’est en lisant Giono que j’ai réalisé que l’écologie pouvait être quelque chose de poétiquement très puissant. Depuis, je creuse ce sillon en cherchant des points de vue plus attractifs pour parler d’écologie. D’une certaine manière Alyte met en scène la rébellion des animaux contre les activités humaines et s’inscrit aussi dans une tradition. Je pense aux Animaux du Bois de Quat’sous, à Watership down, à Pompoko, cette histoire rejoint des archétypes très présents dans la littérature anglo-saxonne. Mais sans refaire ce qui a été fait, avec toutes les recherches menées sur l’intelligence des arbres, l’éthologie des animaux ou la puissance du mycélium, il existe de nouvelles sources d’inspiration. Graphiquement, éviter les clichés implique de trouver de nouvelles solutions. Dans Alyte, cela implique des contorsions, je ne montre pas le bulldozer qui dépouille la forêt, ni les travaux de la route, et les voitures n’apparaissent que dans la lumière des phares.
Cette route, la « léthalyte », littéralement la « tueuse d’alyte » est présentée comme « la mort sœur de la mort » par opposition à « la mort sœur de la vie », Comment as-tu imaginé cette dualité ?
Dans ma première version il n’y avait pas de monde humain, ni de léthalyte, parce que je voulais me concentrer sur la vie du crapaud. J’essaie toujours d’éviter dans mes histoires le recours aux méchants. Seulement dans une tonalité épique, il est difficile de tenir en haleine sans créer un conflit. J’ai essayé mais au bout j’obtenais une série de portraits un peu vaine. C’est Jean-Christophe Cavallin qui m’a suggéré de faire mourir le père au début, puis en voyant les migrations de crapauds sur la route, j’ai eu l’idée de cette route comme un moyen de projeter un monde humain perçu depuis l’extérieur, du point de vue animal comme un alien. En devenant une force à combattre, la route a finalement complètement transformé le scénario et déterminé l’axe du récit. La collection de morts successives des premiers chapitres est là pour rappeler qu’un être vivant n’est jamais que le locataire de l’énergie qu’il transporte dans son corps. Cette mort rend d’autant plus précieux le combat pour la vie. A l’inverse de l’exploitation capitaliste qui fabrique des déchets, prend sans rendre, la nature réutilise, transforme, la vie se nourrit de la mort.
Alyte signifie « qui ne peut être délié », à l’inverse la léthalyte découpe la forêt comme une lame. Mais n’évoque-t-elle pas non plus la ligne stylisée du dessin et le découpage des planches. As-tu joué graphiquement avec ce concept ?
J’ai découvert après coup la signification d’Alyte. Cette magie sémantique éclaire la traduction graphique pour dire le point de vue de la nature, pour créer un contraste entre le tissage du vivant, ce monde des interdépendances, en opposition au monde humain extrêmement rectiligne, coupant, imperméable. La ligne droite n’existe pas dans la nature, c’est une abstraction humaine. A un moment il avait été question que je fasse un album avec Bruno Latour et j’ai aussi travaillé avec Patrice Maniglier. Ce philosophe définit la modernité comme la projection idéale des capacités humaines à exploiter un monde infini, aux ressources inépuisables, l’idée que l’espèce humaine serait à terme capable de tout surmonter et même de dépasser la peur de la maladie et de la mort. Or la crise écologique actuelle contredit cet idéal moderne, comme si cet horizon d’éternité s’était recourbé vers la terre et se retrouve totalement inadapté au regard des ressources finies de notre planète. Toutefois si je me nourris de la philosophie, dans un récit en BD, j’élague beaucoup pour laisser plus de place à la sensation.
Malgré les passages muets, tu as fait le choix de faire parler le crapaud qui reste très expressif dans sa physionomie. Comment tenir à distance l’anthropomorphisme et donner vie au récit en restant dans la perception animale ?
J’ai pensé à Gon le petit dinosaure imaginé par Masashi Tanaka, un manga très naturaliste et sans dialogue. Pour ma part, je voulais aller au bout de mon idée de cosmologie animalière et j’avais besoin de faire parler mes animaux, de même que les animaux communiquent entre eux. Je pars du principe que ma BD s’adressant aux humains, il faut donc traduire. Sporadiquement, en mettant leurs lunettes, il m’arrive de créer quelques mots, mais je ne suis pas friand d’une langue complètement réinventée et retravaillée comme j’ai pu lire chez Damasio par exemple. Je vais chercher des noms très simples, dans les racines latines ou grecques, comme lupus, corax ou lymphore. J’ai aussi vraiment envie de pouvoir m’adresser aussi bien à des enfants qu’à des adultes. Et si dans les dialogues je m’autorise un peu de légèreté pour ne pas faire un récit trop ennuyeux, je reste méfiant avec les travers d’une anthropomorphisation cliché qui reste aussi le fonds de commerce des blockbusters, et qui détourne du point de vue animal en détruisant l’effet poétique.
C’était déjà le cas dans Le Discours de la panthère, sauf qu’ici la dramaturgie est beaucoup plus dynamique.
Tu as aussi introduit des onomatopées qui investissent l’image tout au long du récit. Quel est le sens de cette mise
en scène ?
J’ai baigné dans Dragon Ball Z et j’aime jouer avec tous les codes de la BD comme du manga. Le découpage beaucoup plus classique du Discours de la panthère, donne l’impression d’une petite scène de théâtre où les personnages apparaissent en entier quasiment sur toutes les cases. Avec Alyte, j’avais envie de travailler un point de vue extrêmement subjectif dans un livre beaucoup plus petit, très immersif, avec un effet page turner. C’était l’occasion de revenir à une mise en page plus japonisante pour plonger dans les sensations du crapaud. J’ai travaillé le découpage avec plein d’obliques, des cases gigantesques à fond perdu.
Quant aux onomatopées, j’ai eu cette idée au moment où Alyte est dans le ventre du Chêne qui lui dit d’écouter la grande respiration végétale. J’ai été très marqué graphiquement par le travail de Yuichi Yokoyama où les onomatopées sont partout et recouvrent finalement le dessin, remplissent esthétiquement l’espace. C’était pour moi l’idée de produire des ambiances sonores pour dire les vibrations et les respirations de la nature. Et finalement j’en ai mis partout, elles ajoutent une autre dimension.
Contre le cynisme du renard, Alyte devient le héros de la résistance de la nature, un symbole d’espoir, quelle valeur donner à son combat ?
Le renard incarne pour moi la vision de ceux qui disent après moi le déluge, il faut profiter de ce qui reste et peu importe ce qui arrive. De même que je pensais à Elon Musk en imaginant le bousier rêver d’une autre planète. J’ai parfois l’impression avec mon parcours de graphiste dessinateur de ne pas avoir les épaules pour porter des choses très militantes parce que ce n’est pas dans ma nature. Mais j’admire ceux qui le font comme Alessandro Pignocchi, un auteur de BD qui a vécu dans la ZAD de Notre-Dame-des-landes, proche de Baptiste Morizot et Nastassja Martin, et qui a publié dernièrement une série d’entretiens avec Philippe Descola, Ethnographie des mondes à venir. Je vois une énorme beauté dans ces combats et je ne peux pas m’empêcher de les réintégrer dans mes histoires.
La quête d’Alyte pour sauver ses enfants est aussi celle qui venge la mort de son père. La transmission est-elle finalement l’enjeu de toute cette histoire ?
J’avais lu Nietzsche et la vie de Barbara Stiegler dans lequel l’autrice revient sur la mémoire de l’eau en évoquant les échanges entre un organisme et son milieu et en interprétant le processus d’incorporation chez Nietzsche. Cette faculté de faire entrer le monde en nous, de le digérer transforme la manière dont on agit sur le monde. Je trouve cette espèce de boucle magnifique. Pour moi la fonction fondamentale de la vie, c’est la transmission aux générations futures. Alyte porte en lui l’héritage de son père mais s’engage véritablement dans la bataille de l’existence quand il a la responsabilité d’autres vies. Je pense qu’à l’origine, beaucoup d’activistes luttent pour leurs enfants car au-delà, la grande question, c’est celle du monde qu’on laisse pour l’avenir de l’espèce.